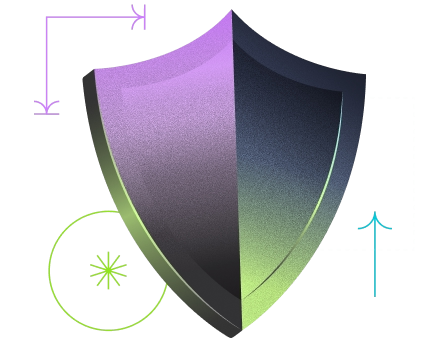La dissolution correspond à la décision de clôturer une société, tandis que la liquidation représente la procédure concrète qui suit cette décision. Ces deux termes peuvent être parfois confondus par les entrepreneurs, mais il s’agit bien de deux étapes distinctes et complémentaires dans la fin de vie des entreprises. Dans cet article, nous allons détailler les définitions, les étapes, les conséquences juridiques et fiscales, et voir comment des outils comme Yousign peuvent faciliter et sécuriser les démarches.
Qu’est-ce que la dissolution d’une société ?
Définition
La dissolution est l’acte juridique qui met fin à l’existence d’une société. Elle ne provoque pas immédiatement sa fermeture, mais elle ouvre une phase transitoire appelée liquidation, durant laquelle les dettes sont réglées et le patrimoine social est réparti.
Elle marque donc la décision officielle de fermer l’entreprise, prise selon des modalités précises, avant sa radiation définitive du registre du commerce et des sociétés (RCS).
La décision dépend du contexte :
- Dans une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société anonyme (SA) : la dissolution est votée par les associés ou actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE). La majorité exigée varie selon les statuts et le type de société.
- Dans une société unipersonnelle (EURL, SASU) : c’est l’associé unique qui prend seul la décision.
- En cas de difficultés graves : le tribunal de commerce peut prononcer la dissolution judiciaire, par exemple si la société est paralysée par des conflits internes ou si elle ne peut plus fonctionner légalement.
Bon à savoir
Pour sécuriser vos décisions d’AGE, tenez la feuille de présence d’assemblée générale.
Causes fréquentes
Plusieurs motifs peuvent conduire à mettre fin à une entreprise :
- Arrivée du terme : si la durée prévue dans les statuts (maximum 99 ans) est atteinte et non renouvelée.
- Décision volontaire des associés : lorsqu’ils souhaitent mettre fin à l’activité, par exemple parce que le projet est terminé, que l’activité n’est plus rentable, ou qu’ils veulent se réorienter.
- Réalisation ou extinction de l’objet social : si la société a atteint son but, comme par exemple celui de construire un projet unique, ou ne peut plus le poursuivre.
- Désaccords graves entre associés : qui empêche le fonctionnement de la société.
- Causes prévues dans les statuts : certaines clauses peuvent prévoir la dissolution automatique en cas d’événement précis (exemple : départ d’un associé clé).
- Décision judiciaire : en cas de nullité de la société, de fraude, ou encore de dissolution anticipée demandée par un associé pour “juste motif”.
Conséquences
Dès que la décision est actée, la société cesse son activité normale. Un liquidateur est nommé (souvent un associé, parfois un tiers ou un professionnel). Il a pour mission de vendre les actifs, payer les dettes et préparer la répartition du solde. Enfin, les formalités obligatoires doivent être accomplies :
- Rédaction d’un procès-verbal (PV) de dissolution
- Dépôt au greffe du tribunal de commerce
- Publication dans un journal d’annonces légales (JAL)
À partir de ce moment, la société est juridiquement dissoute, mais elle conserve sa personnalité morale jusqu’à la clôture de la liquidation.
Qu’est-ce que la liquidation d’une société ?
Définition
La liquidation est la procédure qui suit la dissolution d’une société. Son objectif est de clôturer définitivement l’existence juridique de l’entreprise en réglant toutes ses obligations. Elle consiste à :
- Vendre les actifs de la société (immeubles, matériel, stocks…)
- Rembourser les dettes et indemniser les créanciers
- Répartir le solde restant entre les associés s’il y a un excédent (appelé boni de liquidation)
La liquidation peut prendre deux formes :
- Liquidation amiable (ou volontaire) : décidée par les associés lorsque la société est solvable.
- Liquidation judiciaire : prononcée par le tribunal de commerce si la société est en état de cessation des paiements.
Causes fréquentes
Une société peut être liquidée dans plusieurs situations :
- Dissolution volontaire par les associés : ils décident de fermer l’entreprise (par exemple si l’activité n’est plus rentable ou si le projet est arrivé à son terme).
- Arrivée du terme prévu dans les statuts : si la durée de vie fixée (maximum 99 ans) n’est pas renouvelée.
- Cessation d’activité : la société ne poursuit plus son objet social.
- Décision judiciaire : le tribunal de commerce prononce la liquidation lorsqu’une société est en faillite (état de cessation des paiements sans redressement possible).
Conséquences
La liquidation entraîne plusieurs effets juridiques :
- Perte de pouvoirs des dirigeants : le liquidateur (amiable ou judiciaire) prend le relais et devient le représentant légal de la société.
- Vente du patrimoine social : tous les biens de la société sont vendus pour dégager des liquidités.
- Paiement des dettes : les créanciers sont remboursés selon un ordre de priorité fixé par la loi.
- Radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS) : une fois la liquidation clôturée, la société cesse définitivement d’exister juridiquement.
- Répartition entre associés : si un solde positif subsiste, il est partagé entre eux sous forme de boni de liquidation, soumis à imposition.
Les différences clés entre la dissolution et la liquidation
La dissolution et la liquidation sont deux étapes complémentaires, mais elles ne désignent pas la même chose.
La dissolution est la décision de mettre fin à la société. Elle ouvre une période transitoire où l’entreprise n’a plus pour objet que sa liquidation.
La liquidation est la procédure qui suit cette décision et qui vise à solder les comptes : vendre les biens, régler les dettes, puis répartir ce qu’il reste entre les associés.
Critère | Dissolution | Liquidation |
|---|---|---|
Définition | Décision de mettre fin à la société | Procédure de règlement après la dissolution |
Moment | Première étape | Étape qui suit la dissolution |
Décisionnaire | Associés en assemblée générale, associé unique, ou tribunal (dissolution judiciaire) | Liquidateur désigné (amiable ou judiciaire) |
Objet | Acte juridique qui annonce la fin | Opérations financières et administratives pour clore la société |
Conséquence | La société entre en liquidation, un liquidateur est nommé | Radiation de la société du RCS et disparition définitive de sa personnalité morale |
Quelles sont les étapes à suivre ?
La procédure pour une dissolution de société
La dissolution est la décision officielle de mettre fin à l’entreprise. Elle nécessite plusieurs démarches administratives et juridiques :
Prendre la décision :
- En assemblée générale extraordinaire (AGE) pour les sociétés pluripersonnelles.
- Par décision unilatérale de l’associé unique pour une SASU ou une EURL.
- Par jugement du tribunal de commerce en cas de dissolution judiciaire.
Rédiger le procès-verbal (PV) de dissolution : ce document précise la décision, le motif et le nom du liquidateur.
Nommer un liquidateur : il peut s’agir d’un associé, d’un dirigeant ou d’un tiers. Il devient le représentant légal de la société pendant la liquidation.
Publier une annonce légale : dans un journal habilité du département du siège social, pour informer les tiers.
Déposer un dossier au greffe du tribunal de commerce : comprenant le PV, le formulaire M2 et l’attestation de parution de l’annonce légale.
Exemple : Une SAS de conseil décide de cesser son activité. Lors d’une AGE, les associés votent la dissolution, rédigent un PV et nomment un liquidateur. L’annonce légale est publiée et le dossier est déposé au greffe. La société est juridiquement dissoute et entre en liquidation amiable.
La procédure d’une liquidation de société
Une fois la dissolution décidée, la société entre en phase de liquidation. Le liquidateur doit accomplir les opérations suivantes :
Réaliser l’actif : vendre les biens, encaisser les créances et transformer le patrimoine en liquidités.
Apurer le passif : régler toutes les dettes (fournisseurs, dettes fiscales et sociales, emprunts).
Établir les comptes de liquidation : bilan final qui détaille les opérations réalisées et le résultat de liquidation.
Soumettre les comptes aux associés : pour approbation, lors d’une assemblée générale de clôture.
Publier une annonce légale de clôture de liquidation : pour informer de la fin des opérations.
Déposer le dossier de radiation au greffe : comprenant le PV de clôture, les comptes définitifs et le formulaire M4.
Exemple : Dans la SAS dissoute précédemment, le liquidateur vend le matériel, rembourse les dettes et établit les comptes de liquidation. Après approbation des associés et dépôt du dossier, la société est radiée du RCS et cesse définitivement d’exister.
Quelles sont les conséquences juridiques et fiscales ?
La dissolution entraîne plusieurs conséquences juridiques :
- L’entreprise n’exerce plus son activité normale : son objet social est limité aux opérations de liquidation.
- Les pouvoirs des dirigeants prennent fin : un liquidateur est désigné et devient le représentant légal.
- La décision de dissolution doit être publiée (annonce légale et greffe), pour être opposable aux tiers.
- La société reste une personne morale tant que la liquidation n’est pas terminée.
Elle ouvre la voie à la liquidation qui entraîne quant à elle des conséquences juridiques et fiscales importantes, que nous allons voir tout de suite.
Quelles sont les conséquences juridiques de la liquidation ?
Fin de l’activité : la société n’exerce plus d’activité économique ; son objet social se limite aux opérations de liquidation.
Perte de pouvoirs des dirigeants : le liquidateur (amiable ou judiciaire) devient le représentant légal et prend toutes les décisions nécessaires pour liquider le patrimoine.
Vente et règlement des dettes : le liquidateur vend les biens de la société, recouvre les créances et rembourse les créanciers dans l’ordre prévu par la loi.
Disparition définitive de la société : une fois les comptes de liquidation approuvés et le dossier de radiation déposé, la société est supprimée du registre du commerce et des sociétés (RCS). Elle cesse juridiquement d’exister.
Quelles sont les conséquences fiscales de la liquidation ?
Imposition des résultats de liquidation : les bénéfices réalisés pendant la liquidation (ventes d’actifs, encaissement de créances) sont imposés à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR), selon le régime applicable.
Fiscalité du boni de liquidation :
- Si, après paiement des dettes, il reste un excédent, celui-ci est partagé entre les associés.
- Ce boni est soumis à des droits d’enregistrement de 2,5 %, et une imposition comme dividendes pour les associés (prélèvement forfaitaire unique de 30 % ou option pour le barème progressif avec abattement de 40 %).
Déclarations obligatoires : le liquidateur doit déposer une déclaration fiscale de cessation d’activité et régulariser la TVA ainsi que les charges sociales éventuelles.
Yousign : un outil fiable pour sécuriser vos démarches
La dissolution et la liquidation d’une société impliquent de nombreuses démarches administratives et juridiques : décisions en assemblée générale, rédaction et signature de procès-verbaux, approbation des comptes de liquidation, ou encore dépôt des documents auprès du greffe. Ces étapes nécessitent des signatures valides et opposables juridiquement. C’est là qu’intervient Yousign, prestataire de services de confiance qualifié conforme au règlement européen eIDAS.
La signature électronique de Yousign apporte plusieurs avantages :
- Signature des procès-verbaux à distance : les associés, même éloignés géographiquement, peuvent signer en ligne les décisions de dissolution ou d’approbation des comptes de liquidation.
- Sécurité juridique renforcée : chaque signature électronique est horodatée, traçable et juridiquement reconnue, évitant tout risque de contestation.
- Gain de temps : plus besoin d’organiser des réunions physiques ou des envois postaux pour valider les décisions.
Conformité légale : les signatures électroniques réalisées avec Yousign respectent les standards européens eIDAS, qui garantissent leur validité devant les tribunaux et les administrations.
Conclusion
La dissolution et la liquidation sont deux étapes indissociables de la fin de vie d’une société, mais elles n’ont pas la même portée. La dissolution correspond à la décision de mettre fin à l’entreprise, tandis que la liquidation est la procédure qui concrétise cette décision, en réglant les dettes, en répartissant les actifs et en radiant la société du registre du commerce.
Cette procédure peut s’avérer complexe, c’est pourquoi il est essentiel d’utiliser des outils numériques fiables comme Yousign, qui simplifie et sécurise la gestion des documents : procès-verbaux, comptes de liquidation, approbations à distance.
Passez à la vitesse supérieure
Testez Yousign gratuitement pendant 14 jours