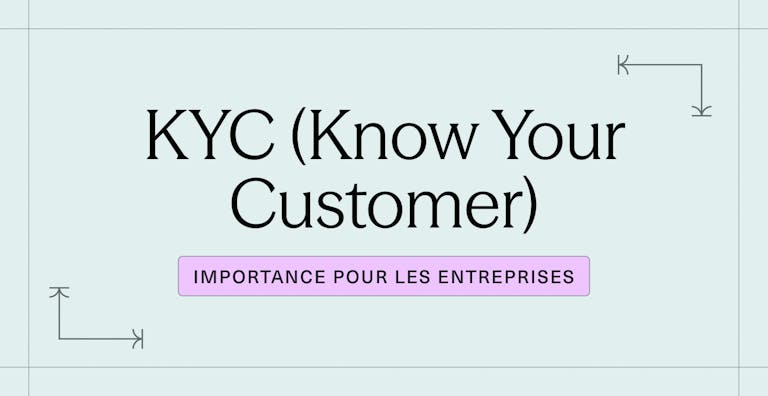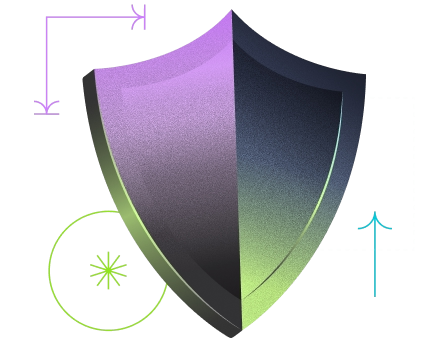Les données médicales sont des données sensibles strictement encadrées par le RGPD. En tant que professionnel de santé, vous devez garantir la sécurité, la traçabilité, et la transparence à chaque étape de leur traitement. De l'information du patient à l'obtention du consentement en passant par le choix des outils, la conformité RGPD est un impératif légal et éthique. Ces obligations légales permettent de sécuriser les datas et d’entretenir une relation de confiance avec chaque patient. Voici les grands principes à connaître, les bonnes pratiques, et les sanctions encourues en cas de non-respect.
Qu’est-ce qu’une donnée de santé au sens du RGPD ?
Définition
Les données médicales sont considérées comme des données sensibles par le RGPD, qui vise à protéger la vie privée des individus de manière renforcée. Selon le règlement général sur la protection des données (art. 4), les données de santé désignent “toutes les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne”.
Cela concerne :
- Le numéro d’inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) et le numéro de sécurité sociale (aussi appelé “numéro d’inscription au répertoire : NIR).
- Les informations sur la génétique des patients
- Les diagnostics de santé : antécédents médicaux, résultats d’examens, imagerie, allergies, pathologies, généalogies…
Les documents médicaux : ordonnances, certificats médicaux, bilans de santé, consentement pour des interventions, mutuelles santé, enregistrements hospitaliers…
Une protection renforcée
L’article 9 du RGPD et l’article 6 de la loi Informatique et Libertés garantissent un niveau de protection renforcé pour les données médicales. Cela signifie que leur traitement est interdit, sauf dans des cas particuliers. C’est par exemple le cas si le traitement des données est nécessaire à des fins médicales, de prévention ou de soins d’une maladie.
Le règlement EHDS, entré en vigueur en mars 2025, vise également à faciliter l’échange sécurisé des informations médicales au sein de l’UE, tout en renforçant les garanties pour les patients. Tous ces dispositifs ont pour but d’assurer une protection maximale pour ces données personnelles sensibles, de la part des organismes privés et publics.
Quels sont les grands principes du RGPD appliqués aux données médicales ?
Licéité, loyauté et transparence
La licéité signifie que tous les médecins et organismes médicaux doivent collecter et traiter les données de santé de manière légale (RGPD art. 9.2). Par exemple, un médecin généraliste peut traiter les informations de son patient afin d’établir un diagnostic sans demander un consentement écrit, car cela fait partie de sa prise en charge directe.
La loyauté signifie que tout professionnel de santé doit agir dans l'intérêt du patient, sans tromperie ni traitement détourné. Cela exclut notamment les traitements des données à des fins commerciales.
La transparence implique qu’il est obligatoire d’informer le patient sur les données collectées, leur finalité, la durée de conservation, les droits du patient (accès, rectification, opposition…), et les mesures de sécurité mises en place.
Finalité
Toute collecte d’informations de santé doit avoir une finalité précise, que les professionnels peuvent justifier et expliquer. La finalité doit être déterminée à l’avance, explicite, et légitime.
Ce qui est autorisé | Ce qui est interdit |
|---|---|
|
|
Minimisation des données
En tant que professionnel de santé, vous devez collecter uniquement ce qui est nécessaire au suivi médical, à la gestion administrative, ou à une obligation légale. Collecter des informations superflues ne fait qu’augmenter le risque d’atteinte aux libertés des patients en cas d’infraction (piratage, fuites de données personnelles…).
Conservation limitée
Vous devez définir une durée de conservation pour chaque type de donnée. À la date d’expiration, il est obligatoire de la supprimer, ou de l’anonymiser si elle est conservée à des fins statistiques ou scientifiques.
Bon à savoir
La durée de conservation d’un dossier médical dans un établissement de santé est généralement de 20 ans. Cependant, cette durée peut varier en fonction de certains critères spécifiques, comme le décès du patient par exemple.
Sécurité et confidentialité
Les données doivent être protégées de toute divulgation, perte, ou accès non autorisé. Cela implique :
- Le chiffrement des données en transit et au repos.
- Des accès restreints et traçables.
- L’utilisation d’outils certifiés (hébergement HDS, logiciels métier conformes).
- Une gestion des violations (plan d’alerte et notification à la CNIL sous 72h).
Bon à savoir
L’utilisation de la signature électronique, avec une solution certifiée comme celle de Yousign, permet de garantir la licéité grâce à une preuve de consentement du patient. Elle garantit également la traçabilité des échanges, la protection de l’intégrité des documents signés, et l’archivage sécurisé et légal.
Quelles sont les bonnes pratiques pour gérer les données médicales ?
Tous les professionnels de santé ont pour obligation de :
- Tenir un registre des traitements.
- Désigner un DPO ( délégué à la protection des données) si la structure est importante.
- Respecter le secret médical.
- Mettre en œuvre un plan d’action en cas de violation.
Pour cela, voici les bonnes pratiques à mettre en place.
Informer clairement les patients de la collecte
Le patient doit être informé de manière compréhensible sur :
- Les datas collectées.
- La finalité du traitement.
- La base légale.
- Les destinataires éventuels (laboratoires partenaires, CPAM…).
- Ses droits d’accès.
Pour cela, vous pouvez afficher les informations dans la salle d’attente, mentionner les règles du RGPD dans les formulaires d'admission ou de consentement, ou encore dédier une page de votre site web à ces sujets.
Obtenir un consentement clair et éclairé
Le consentement du patient devient obligatoire dès lors que le traitement d’une information ne relève pas directement du soin. Ce consentement doit être libre, éclairé, documenté et spécifique. Pour cela, vous pouvez utiliser des outils comme la signature électronique conforme au règlement européen eIDAS, comme celle de Yousign. La plateforme vous permet d’envoyer, de recevoir et de signer des documents en toute légalité, d’identifier le signataire, d’assurer l’authenticité des fichiers, de les tracer et de les archiver.
Utiliser des outils conformes
Les outils utilisés dans le cadre d’un traitement de données médicales doivent respecter les normes en vigueur. Cela concerne :
- Les logiciels de gestion de dossiers médicaux.
- Les plateformes de téléconsultation.
- Les messageries sécurisées.
- Les services de signature et d’archivage.
En France, l’hébergement des données de santé est soumis à une certification obligatoire dite HDS (Hébergeur de Données de Santé).
Bon à savoir
Si vous faites appel à des prestataires externes pour l'hébergement ou le traitement de données médicales, assurez-vous qu'ils respectent le RGPD dans vos relations de sous-traitance avec des contrats conformes à l'article 28.
Gérer les accès et les habilitations
L’accès aux données de santé doit être limité aux seules personnes habilitées, selon le principe du « moindre privilège ».
Voici les mesures à mettre en place :
- Comptes utilisateurs nominatifs (jamais de compte partagé).
- Authentification forte (mot de passe complexe + double facteur si possible).
- Traçabilité des connexions (journalisation des accès).
- Suppression immédiate des accès en cas de départ d’un collaborateur.
Prévoir un plan d’action en cas d’incident
Vous devez être en mesure de réagir rapidement en cas de perte ou vol de données, de piratage, ou d’envoi par erreur à un tiers. Cela implique :
- Un plan d’alerte en interne.
- La notification obligatoire à la CNIL sous 72 heures si la violation peut avoir un impact sur les droits des personnes concernées.
- Prévenir les personnes concernées si le risque est élevé.
Bonne pratique | Objectif | Outil recommandé |
|---|---|---|
Informer le patient | Transparence RGPD | Affichage, documents, site web |
Documenter le consentement | Preuve légale, loyauté | Signature électronique certifiée comme Yousign |
Choisir des prestataires conformes | Sécurité et conformité RGPD | Hébergeurs HDS, logiciels certifiés |
Restreindre les accès aux données | Confidentialité, traçabilité | Comptes nominatifs, journalisation |
Prévoir un plan d’incident | Réactivité en cas de fuite | Modèle de procédure, notification CNIL |
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des obligations ?
Voici les principales sanctions encourus en 2025 en cas de non-respect des obligations, ou violation du RGPD :
- Mise en demeure : avant l’amende, la CNIL peut envoyer une mise en demeure à un professionnel ou à une structure, exigeant un délai précis pour la mise en conformité.
- Amendes : la CNIL peut infliger des amendes allant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial, en retenant le montant le plus élevé des deux (art. 83 du RGPD).
- Sanctions civiles : un professionnel ou un établissement peut être condamné à verser des dommages et intérêts à un patient qui entame et remporte une action en justice pour violation de ses données personnelles.
- Sanctions pénales : la collecte frauduleuse ou le détournement des données peut être puni par des amendes, mais aussi par des années d’emprisonnement.
- Sanctions disciplinaires : un manquement aux règles, en fonction de sa gravité, peut entraîner un avertissement ou un blâme, une suspension temporaire, ou encore une radiation de l’Ordre.
Conclusion
La protection des données médicales est une obligation légale pour tous les professionnels de la santé. En tant que soignant, vous devez donc appliquer les principes du RGPD, choisir des outils conformes, informer clairement vos patients et sécuriser chaque étape du traitement des données.
Des solutions comme Yousign viennent renforcer cette démarche dans un cadre 100% conforme, en optimisant la gestion numérique de vos documents.
Passez à la vitesse supérieure
Testez gratuitement Yousign pendant 14 jours

FAQ
Toutes les données liées à la santé sont-elles protégées de la même manière ?
Oui. Dès qu’une donnée permet d’identifier un patient et est liée à son état de santé physique ou mentale, elle est considérée comme sensible au sens du RGPD.
Peut-on utiliser la signature électronique pour les documents médicaux ?
Oui, à condition qu’elle soit conforme aux normes européennes (règlement européen eIDAS). C’est le cas de Yousign, qui offre une solution sécurisée, légale et simple d’utilisation.
Que faire en cas de fuite de données de santé ?
Il faut notifier la CNIL sous 72h, informer les personnes concernées si nécessaire, et corriger immédiatement la faille.
La CNIL peut-elle effectuer un contrôle dans mon cabinet ?
Oui. Tout professionnel ou établissement de santé peut faire l’objet d’un contrôle RGPD, sur place ou à distance. Il est donc important de tenir un registre des traitements et d’utiliser des outils conformes.
Un professionnel libéral est-il obligé d’avoir un DPO ?
Non, sauf s’il traite un volume important de données. Dans la plupart des cas, un cabinet libéral n’est pas concerné, mais doit malgré tout respecter toutes les autres obligations.